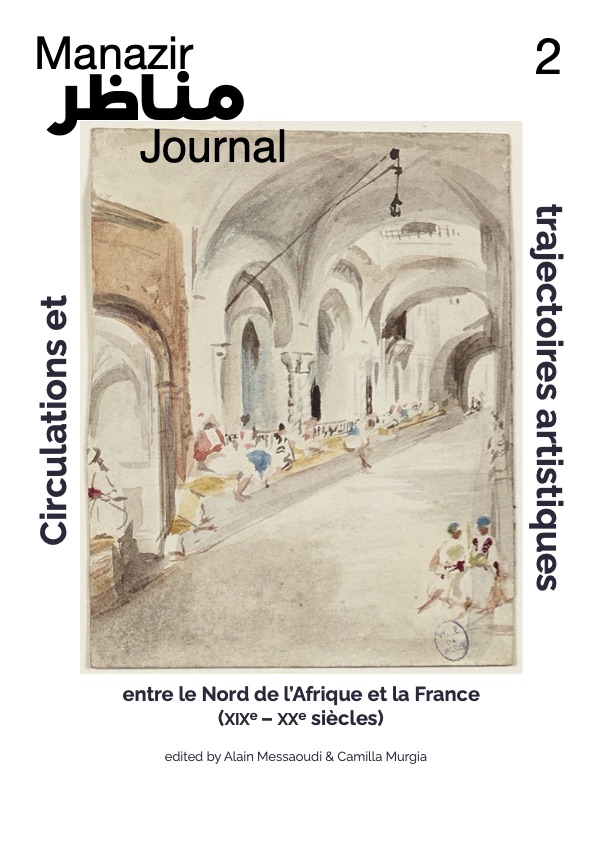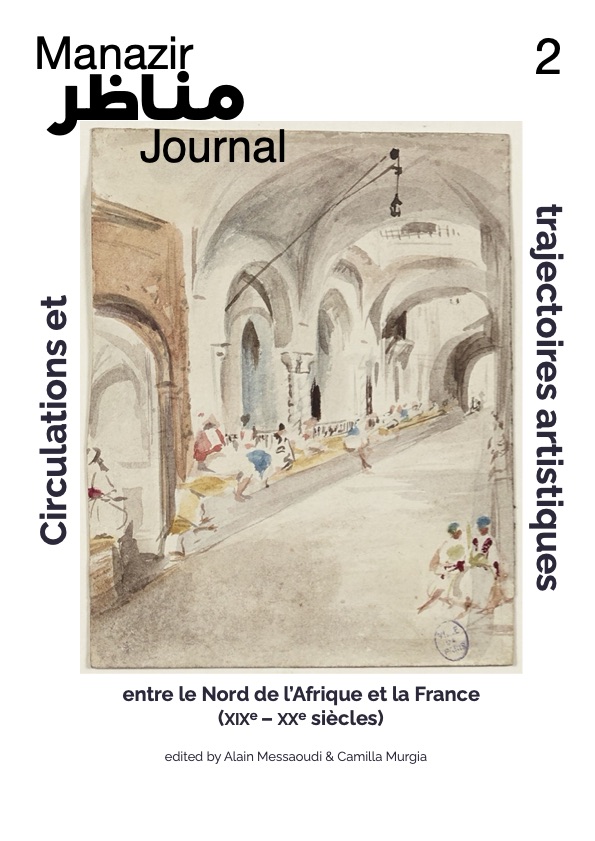Volume 2Circulations et trajectoires artistiques entre le Nord de l’Afrique et la France (XIXe-XXe s.)
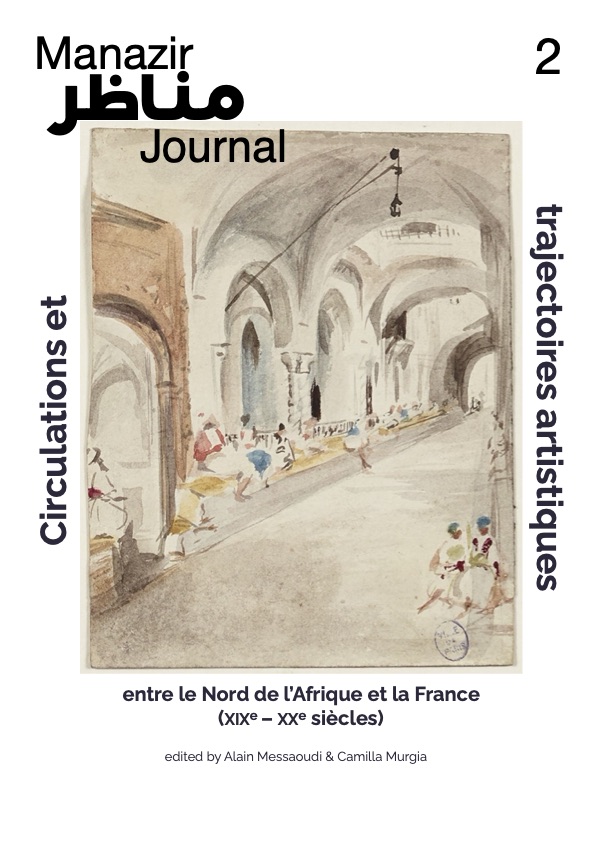
Description du numéro
Depuis le XIXesiècle, le Nord de l’Afrique, de l’Égypte au Maroc, a connu de profonds bouleversements, liés à l’expansion impériale et coloniale des puissances européennes et à la politique de ré-ordonnancement (tanzimāt) de l’Empire ottoman, puis au processus de décolonisation et à l’affirmation d’États-nations. Ces mutations qui furent à la fois économiques, sociales, politiques et culturelles s’accompagnèrent de références à des modèles européens. C’est plus précisément aux références à des œuvres ou plus généralement à une culture française dans les productions locales que nous entendons consacrer ce dossier, en nous attachant à comprendre leurs modalités. Le contact avec la France a pris des formes différentes. En Égypte, après l’épisode de l’occupation française entre 1798 et 1801 et la forte présence des conseillers français dans la politique de réforme de l’État menée par Méhémet Ali, la culture française a pu représenter une forme de contestation par rapport à la présence britannique après 1881. En Algérie, la France a pris le contrôle du pays par les armes, et encouragé une colonisation de peuplement accompagnée d’un discours assimilationniste. Les protectorats français en Tunisie et au Maroc ont pu favoriser le développement d’une image ambivalente de la France, tutrice favorisant un processus de développement spécifique ou puissance abusive l’étouffant, et devant prendre en considération des modèles étrangers concurrents, italien en Tunisie ou espagnol au Maroc.
Dans le domaine des arts, les références explicites à la France ou les transferts culturels implicites ont pris des formes nombreuses et variées. On s’intéressera ici aux expressions d’une ouverture à des références françaises aussi bien à des formes de réaction ou de refus devant des modèles présentés comme étrangers ou imposés par la force, dans différentes formes de productions artistiques, arts visuels mais aussi musique, pour y étudier les modes d’appropriation, de mise en question et de compréhension.